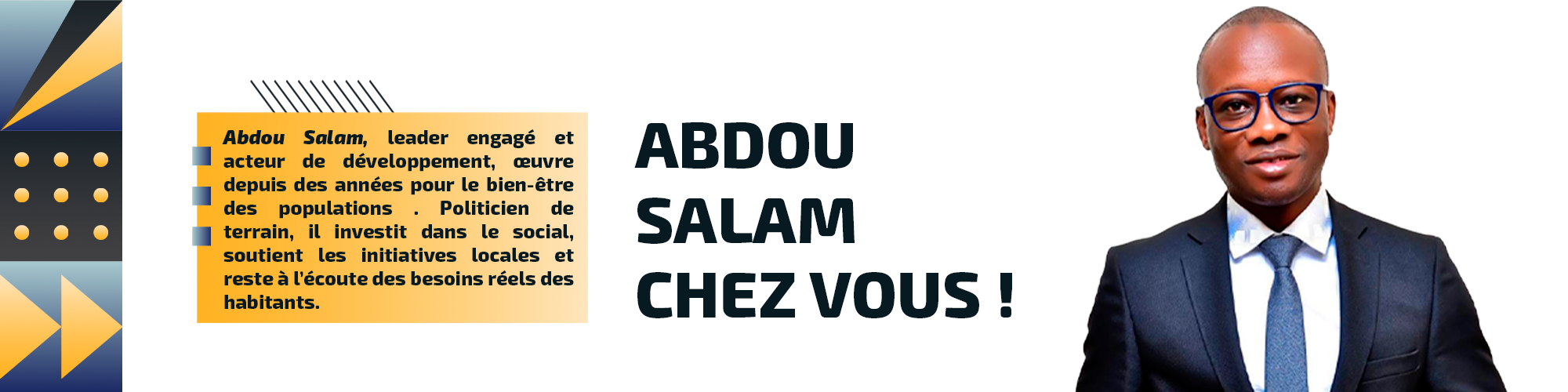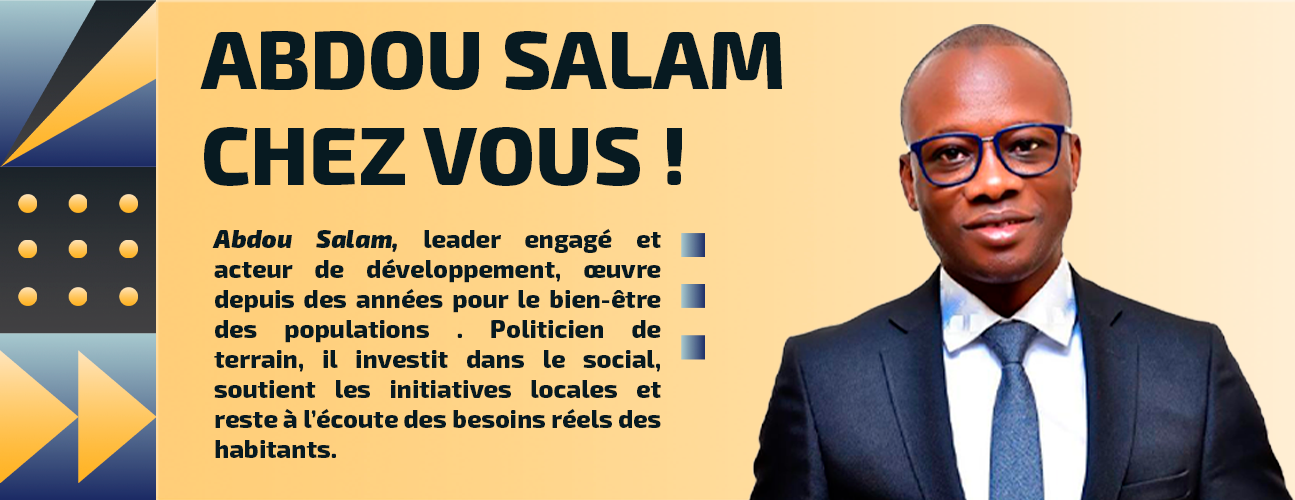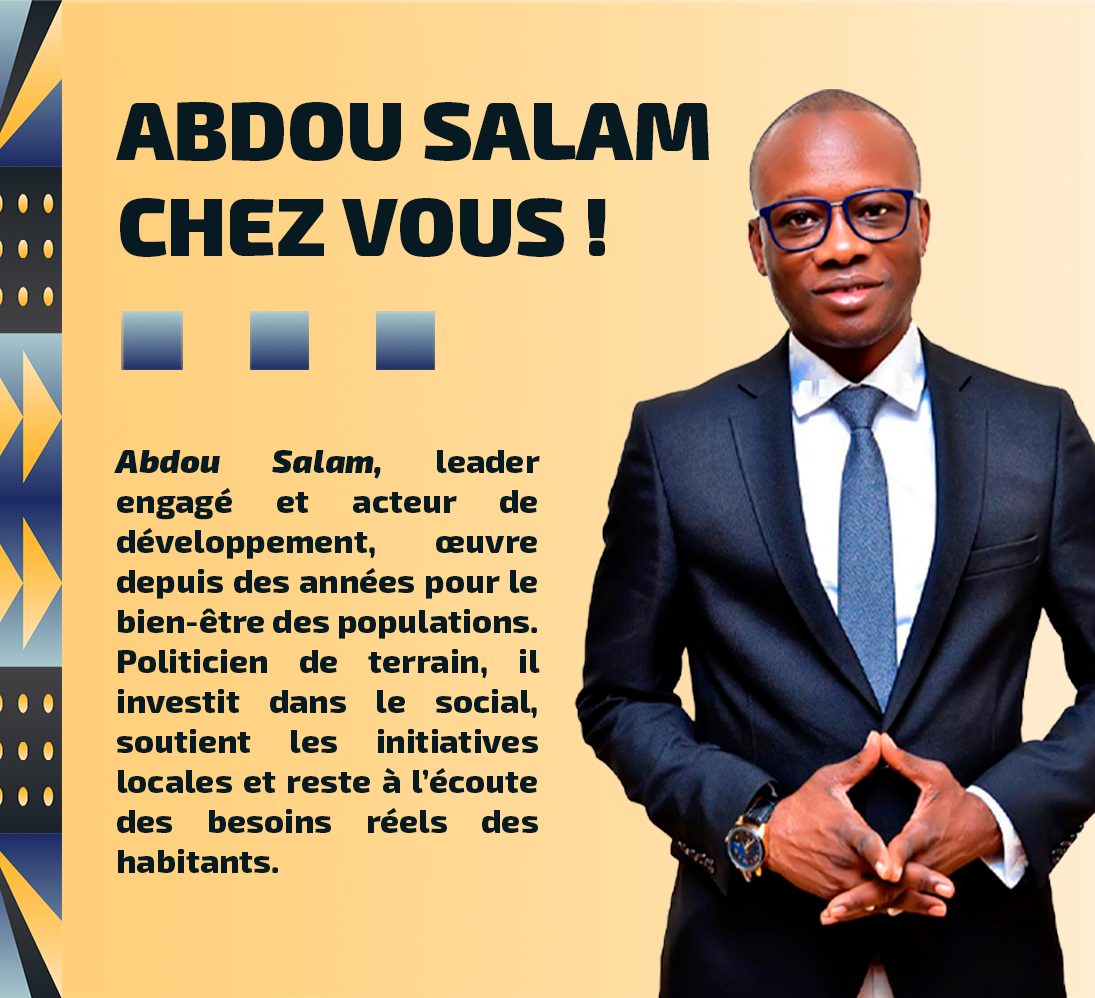Présent au colloque national sur les mangroves, le Colonel Mamadou Sidibé, représentant du ministère de l’Environnement, a insisté sur l’urgence de protéger ces zones critiques. Il a salué le rôle déterminant des communautés locales et des femmes dans la conservation de ces écosystèmes, tout en appelant à une synergie entre savoirs traditionnels et sciences modernes.
Les mangroves sénégalaises, véritables trésors écologiques, occupent une place stratégique dans plusieurs deltas du pays : Saloum, Casamance, fleuve Sénégal et fleuve Gambie. Ces zones humides, à la fois nourricières, protectrices et écologiques, offrent une grande diversité en fonction de leur situation géographique. Certaines, influencées par l’eau douce, comme celles du delta du fleuve Gambie et du fleuve Sénégal, contrastent avec celles plus salines du Saloum et de la Casamance. Pour le Colonel Mamadou Sidibé, directeur des aires marines communautaires protégées et représentant du ministère de l’Environnement au colloque, « ces écosystèmes complémentaires sont tous indispensables à la stabilité écologique et économique du pays ».
Mais leur survie est aujourd’hui compromise. Le colonel n’a pas mâché ses mots pour alerter sur les menaces croissantes : déboisement, exploitation incontrôlée, urbanisation anarchique. « L’urbanisation est en train de grignoter nos écosystèmes côtiers. Si nous ne faisons rien, c’est une richesse nationale qui disparaîtra », a-t-il prévenu, ajoutant que certaines infrastructures ont déjà rogné sur des zones protégées.
Ainsi, face à cette situation, le Sénégal a élaboré une stratégie nationale de restauration et de conservation des mangroves. Celle-ci repose notamment sur la création d’aires marines protégées initiées par les communautés locales, mais aussi sur des campagnes de reboisement menées en lien avec les collectivités territoriales et les partenaires techniques. Pour le colonel, « les communautés jouent un rôle clé, et il faut renforcer leur implication ».
Au cœur de cette mobilisation se trouvent les femmes, dont l’apport est fondamental. Présentes dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la récolte des coquillages à leur transformation. Elles sont en première ligne dans la gestion durable de ces ressources. « Leur implication est totale. Ce sont elles qui font vivre ces écosystèmes autant qu’elles en vivent », a-t-il souligné, appelant à une reconnaissance plus grande de leur rôle.
Le colloque a aussi été l’occasion pour le colonel, d’insister sur la nécessité d’unir les savoirs. Car pour gérer durablement les mangroves, le colonel plaide pour une approche intégrée, où les connaissances scientifiques croisent les savoirs endogènes des populations riveraines. « La science seule ne suffit pas. Il faut écouter ceux qui vivent dans ces écosystèmes depuis des générations. »
Au-delà de l’aspect environnemental, les mangroves sont également un pilier économique et social pour de nombreuses familles. « Ces écosystèmes nous ont nourris, soignés, éduqués. Nous leur devons beaucoup », a déclaré le colonel avec émotion, rappelant que de nombreuses vies ont été construites autour de cette richesse naturelle.