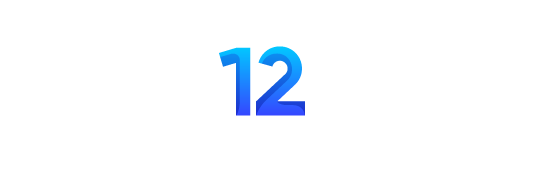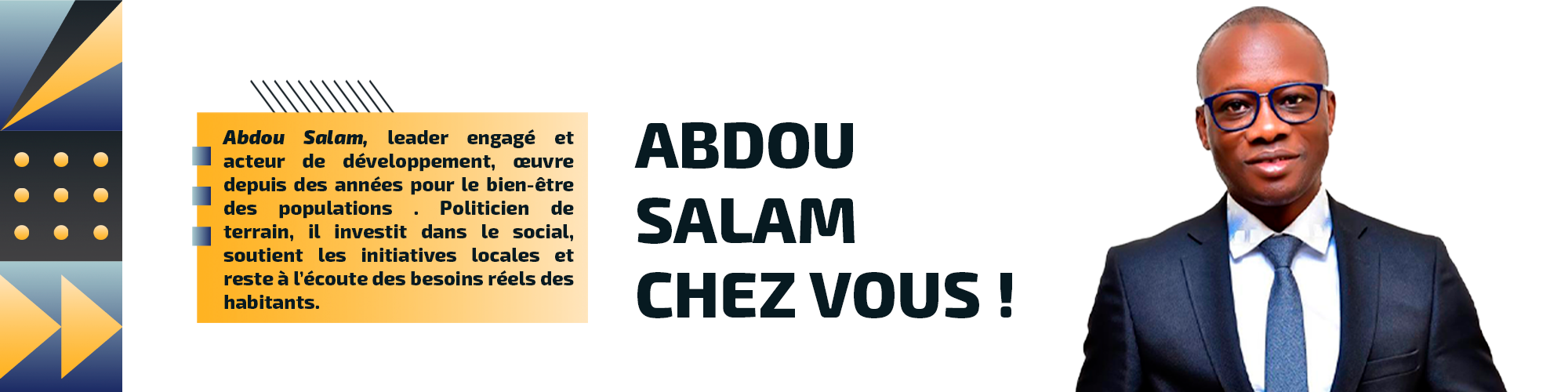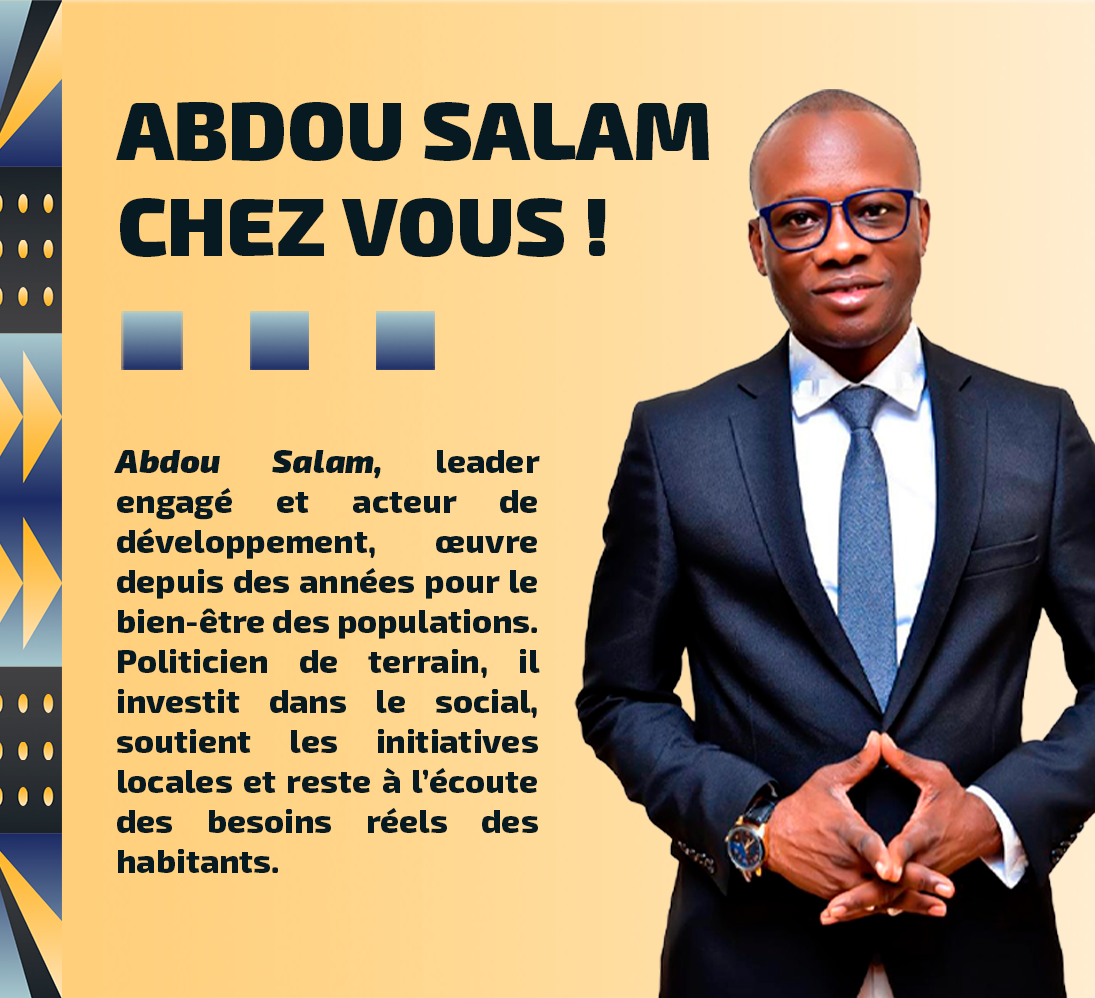La campagne horticole 2024-2025 s’est achevée sur un bilan jugé « particulièrement encourageant » par le Directeur de l’Horticulture, Cheikh Ahmet Bassirou Sané, dans un entretien accordé au Soleil. En effet, selon lui, pour la première fois, la production nationale de fruits et légumes a franchi la barre des 2,6 millions de tonnes. « Les chiffres sont éloquents : 493.287 tonnes d’oignon, 211.000 tonnes de pomme de terre et 78.155 tonnes de banane ont été récoltées. Comparée à l’année précédente, la progression est spectaculaire : +23,7 % pour l’oignon, +48,4 % pour la pomme de terre et +108,4 % pour la banane.
Ces résultats dépassent largement les prévisions initiales et rapprochent le Sénégal de son ambition de souveraineté alimentaire », a-t-il détaillé. « Ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles traduisent la résilience et la détermination des acteurs du secteur, appuyés par l’État et engagés dans une dynamique collective », a-t-il ajouté. Un appui fort de l’État Derrière ces résultats se cache une politique volontariste. L’État a mobilisé 19,7 milliards de FCfa pour subventionner les intrants horticoles, notamment les semences et les engrais. Cette enveloppe a permis l’importation de 11.945 tonnes de semences de pomme de terre de haute qualité, ainsi que la distribution de 44.500 tonnes d’engrais minéraux, 22.000 litres d’engrais foliaires et 7.700 tonnes d’amendements organiques. La stratégie a également mis l’accent sur la souveraineté semencière. En plus des semences importées, 7.000 tonnes de semences locales ont été produites et distribuées.
Des programmes de soutien à la recherche et à l’innovation ont permis de subventionner 500.000 vitroplants et 1.000 tonnes de semences élites destinées à renforcer l’autonomie de la filière pomme de terre. « La maîtrise des semences est un enjeu central. Elle conditionne la durabilité de notre production et réduit notre dépendance extérieure », a souligné Le Directeur de l’Horticulture. Quand l’abondance devient un défi Outre l’appui matériel, une meilleure coordination a contribué à l’efficacité de la campagne. La collaboration entre producteurs, commerçants, transporteurs et l’Agence de régulation des marchés (Arm) a permis de fluidifier les circuits de distribution et de limiter les pertes, d’après M. Sané.
La politique d’import-substitution a également joué un rôle déterminant. En gelant temporairement les importations d’oignon, de carotte, de banane et de pomme de terre, le gouvernement a protégé les producteurs locaux de la concurrence étrangère et stimulé la production nationale. Si l’offre locale s’est imposée, cette réussite met en lumière un problème structurel : l’absence d’infrastructures de stockage et de transformation.
La surabondance des récoltes sur les marchés entraîne inévitablement une chute des prix et des pertes post-récolte. Aujourd’hui, ce ne sont plus les pénuries qui inquiètent, mais bien la gestion de l’abondance. Les producteurs de pomme de terre, d’oignon ou de carotte voient une partie de leurs récoltes invendues ou bradées, faute de moyens pour étaler la commercialisation sur l’année. « L’inondation du marché n’est pas un problème de production, mais un problème logistique et de transformation », reconnaît d’ailleurs M. Sané. Pour relever ce défi, les autorités veulent accélérer les investissements dans les infrastructures de stockage et la chaîne du froid. Des partenariats public-privé sont envisagés pour construire des chambres froides et des magasins modernes, capables de réguler le marché et de réduire les pertes. La transformation agroalimentaire est aussi au cœur de la stratégie.
Produire des jus, purées, conserves ou légumes surgelés permettrait non seulement de réduire le gaspillage, mais aussi de créer de la valeur ajoutée et de nouveaux débouchés, y compris à l’export. « Nous devons passer de la bataille de la production à celle de la valorisation. L’avenir de notre agriculture repose sur l’industrialisation », a-t-il avancé. Pérenniser les acquis : trois axes stratégiques La stratégie gouvernementale pour consolider ces acquis repose sur trois piliers, selon le Directeur de l’Horticulture. Il cite en premier le renforcement de la résilience de la filière.
Ce qui sous-entend d’investir dans la maîtrise de l’eau avec l’irrigation moderne, les micro-barrages et une meilleure gestion des ressources hydriques ; de développer des semences adaptées aux changements climatiques, en partenariat avec les centres de recherche ; de diversifier les systèmes de production (fruits, légumes, élevage, pisciculture) et d’étaler les récoltes tout au long de l’année. Le deuxième pilier, selon M. Sané, c’est la modernisation de la chaîne de valeur qui passera par la construction des infrastructures de conservation pour réguler l’offre, l’implantation d’unités industrielles de transformation pour absorber les surplus et la stimulation des exportations.
Le troisième pilier est l’amélioration de la gouvernance et l’accès au financement qui implique le renforcement de l’organisation des producteurs en coopératives agricoles capables de négocier de meilleurs prix, la digitalisation de la filière pour assurer une transparence dans la distribution des intrants et dans le suivi des marchés. Pour Cherif Ahmet Bassirou Sané, la campagne horticole 2024-2025 illustre la transition du Sénégal vers un modèle agricole plus autonome et performant.
Mais il admet que ce succès ne sera durable que si l’État et les acteurs privés s’attaquent rapidement au maillon faible : l’après-récolte. « Nous sommes passés de la problématique de la pénurie à celle de l’abondance. C’est une victoire, mais aussi un nouveau défi. À nous de le transformer en opportunité pour nos agriculteurs et pour l’économie nationale », conclut le Directeur de l’Horticulture.