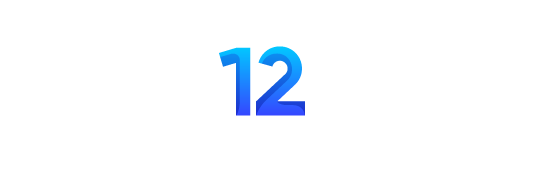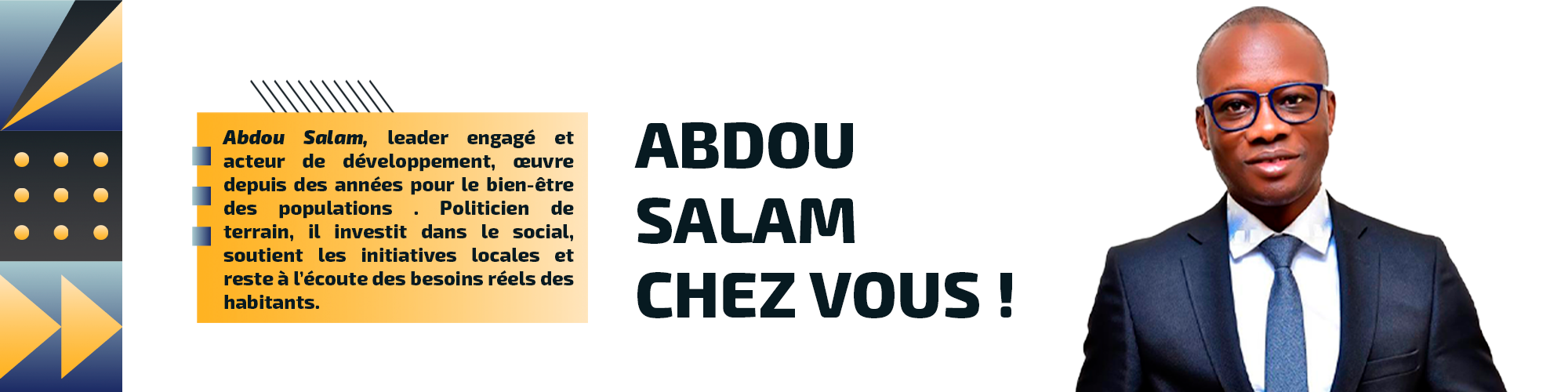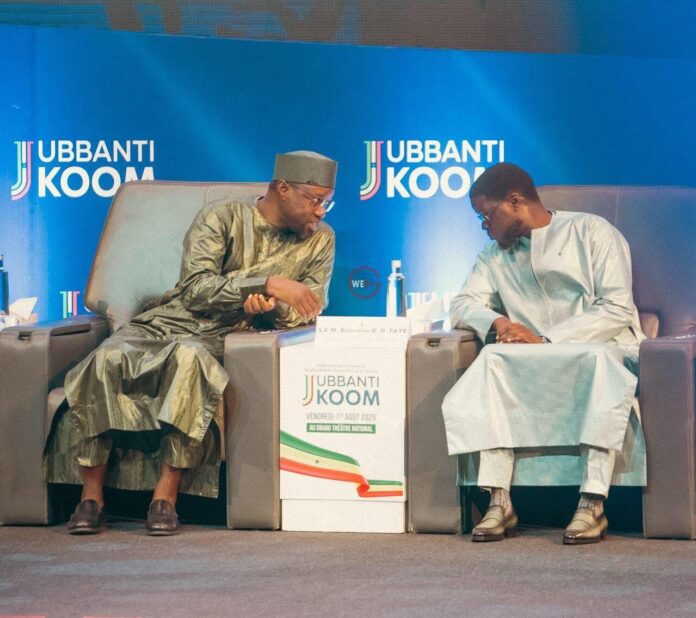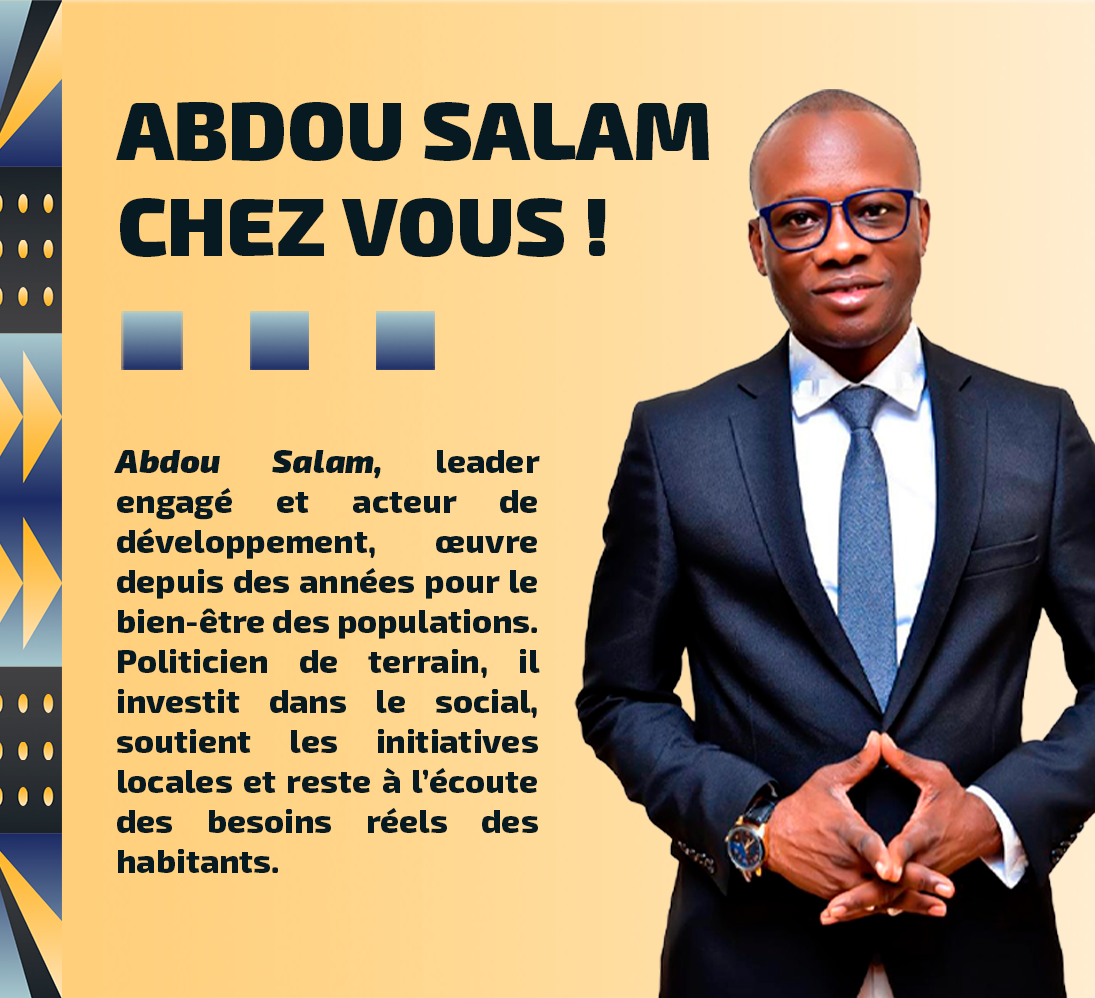Par Aliou Gori DIOUF,
Spécialiste en planification et financement climatique
« Beaucoup de pays en développement supportent des dettes contractées par des dirigeants qui ont emprunté sans l’accord de la population et employé ces fonds à des fins de répression ou d’enrichissement personnel. Une nouvelle approche s’impose pour empêcher les dictateurs d’emprunter, de piller leur pays et de léguer leurs dettes à la population. ». Michael Kremer et Seema Jayachandran « La dette «odieuse». Finances & Développement / Juin 2002. Pp36-39
INTRODUCTION
Au Sénégal, la question de la dette publique est devenue un enjeu central de gouvernance et de souveraineté nationale. Le poids croissant du service de la dette, qui absorbe une part considérable des recettes budgétaires et limite la capacité de l’État à financer les secteurs sociaux essentiels, suscite une inquiétude légitime. Dans ce contexte, permettre aux citoyens de comprendre l’origine, la nature et la légitimité des dettes contractées, afin de distinguer celles qui servent réellement l’intérêt général de celles qui relèvent de pratiques opaques, voire illégitimes est devenue une exigence nationale. Face à cette situation, l’appel à un audit citoyen de la dette publique du Sénégal s’impose.
Faut-il voir dans l’audit citoyen de la dette un aveu d’échec du gouvernement, incapable d’assumer ses responsabilités, ou une tentative de la société civile de se substituer à l’État ? Telles sont les critiques souvent entendues. Sont-elles fondées ? En quoi consiste un audit citoyen ? Qu’est ce qui justifie qu’au Sénégal, un audit citoyen de la dette s’impose ? Qu’est ce qu’apporte un audit citoyen ?
I. L’audit citoyen de la dette, un levier de consolidation de la légitimité de l’action publique et de raffermissement du lien de confiance entre les citoyens et leur gouvernement.
Certains pensent qu’un audit citoyen est une entreprise parallèle qui viendrait supplanter ou délégitimer l’action du gouvernement et de donner illégalement, aux acteurs des forces vives, notamment de la société civile, des pouvoirs gouvernementaux. D’autres y voient un acte de défiance à l’égard des créanciers, un signal envoyé à la communauté internationale selon lequel le Sénégal pourrait, à tout moment, remettre en cause ou rompre ses engagements financiers. Sous ce rapport, l’audit serait susceptible d’inquiéter les partenaires et de fragiliser la crédibilité du pays sur les marchés.
Mais ces jugements rapides occultent l’essentiel : lorsque le service de la dette égale presque toutes les recettes internes et prive le pays de ressources vitales pour la santé, l’éducation, l’agriculture, la sécurité ou l’emploi, la question cesse d’être purement technique. Elle devient existentielle.
L’audit citoyen de la dette ne saurait se concevoir en dehors du cadre institutionnel. Bien au contraire, sa légitimité et son efficacité reposent sur l’articulation entre les forces vives et les institutions républicaines. C’est précisément pour cette raison que l’appel à un audit citoyen a préconisé la mise en place d’un comité (pluraliste et inclusif), chargé de conduire le processus. Ce comité ne serait pas un espace d’opposition à l’État, mais un lieu de convergence : il associerait les structures gouvernementales compétentes, les institutions constitutionnelles comme l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et les organes de contrôle, aux côtés des forces vives de la nation – syndicats, organisations de la société civile, universitaires, acteurs du secteur privé, et représentants des communautés locales. Une telle composition garantit deux choses :
• d’une part, l’ancrage institutionnel, qui assure que l’audit s’opère dans le respect des règles républicaines, sans sortir du giron de l’État ;
• d’autre part, l’ancrage citoyen, qui permet de restaurer la confiance du peuple dans la gestion de la dette, de renforcer la transparence et d’élargir la base sociale des décisions.
En réalité, loin d’être une tentative de substitution, l’audit citoyen est une démarche de co-responsabilité. Il reconnaît à l’État son rôle central de garant de l’intérêt général, tout en affirmant que, face à une crise de la dette qui engage l’avenir de tous, la voix du peuple doit être entendue et intégrée.
Ainsi conçu, l’audit citoyen n’est pas une menace pour l’autorité de l’État, mais une opportunité de la consolider. Il place les institutions républicaines devant leurs responsabilités, tout en leur offrant le soutien populaire nécessaire pour affronter les créanciers. Il en ressort non pas un dualisme, mais une synergie : un gouvernement et un peuple unis, parlant d’une même voix pour exiger que la dette serve enfin le développement et non la fragilisation de la nation.
II. Quand la dette devient une question de survie, l’audit citoyen devient une exigence
Au Sénégal, la dette publique n’est plus un simple dossier de technocrates. Elle est devenue une affaire de survie nationale. En effet, le paiement du service de la dette extérieure a représenté 41,7% des recettes budgétaires et 38,6% des exportations contre des plafonds respectifs de 22% et 25% retenus dans le cadre de l’analyse de viabilité de la dette (CVD).
C’est dans ce contexte qu’émerge une exigence citoyenne fondamentale : celle de la transparence, de la vérité et de l’appropriation populaire du problème, à travers un audit citoyen de la dette. Car l’enjeu n’est plus de savoir si la dette est soutenable ou non : lorsque le montant du service de la dette équivaut la quasi-totalité du montant des recettes internes, la soutenabilité cesse d’être un débat académique. C’est devenu une réalité dramatique. C’est une crise de la dette que nous vivons. On emprunte le plus souvent pour payer la dette. Les marges d’investissement sont gravement réduites. La question n’est plus de calculer la soutenabilité budgétaire, mais de poser une question politique et morale : quelles dettes doivent être reconnues et honorées par celui qui paie, en l’occurrence le peuple, et quelles dettes doivent être rejetées comme illégitimes ou illicites parce qu’illégales ?
Dans un tel contexte, il est absurde, et profondément injuste, de demander à un peuple déjà confronté à des déficits alimentaires, éducatifs, sanitaires et sociaux de continuer à payer des dettes qui, dans bien des cas, n’ont ni été contractées dans son intérêt, ni utilisées pour répondre à ses besoins vitaux.
L’enjeu véritable est désormais politique et social : il s’agit de mobiliser un vaste mouvement citoyen et populaire autour de cette dette devenue insoutenable. Car quelles que soient les mesures adoptées et sa volonté de dégager des ressources, le gouvernement n’aura plus de marges budgétaires suffisantes pour investir de manière significative dans les secteurs vitaux, à savoir l’éducation, la recherche, la santé, l’agriculture, les infrastructures, l’industrie, la sécurité, entre autres. Or, il est inacceptable que le pays soit placé devant l’alternative absurde de devoir choisir entre garantir les droits économiques et sociaux fondamentaux de sa population et honorer des créances.
III. L’audit citoyen de la dette, un acte de légitimité politique et morale
Ce refus de sacrifier le peuple sur l’autel de la dette est d’autant plus légitime qu’une partie de cette dette est illicite : contractée en violation des lois et règlements, elle ne saurait être considérée comme légale ni, par conséquent, comme une véritable dette du peuple sénégalais. Un audit citoyen de la dette n’est donc pas un acte de rébellion mais une exigence de survie. Il pose une question fondamentale : quelles dettes le peuple doit-il reconnaître et honorer, et quelles dettes doivent être rejetées car contractées en violation des lois ou détournées de leurs finalités ?
La situation du Sénégal peut être éclairée par une métaphore simple. Imaginons une famille dans laquelle un membre reçoit mandat pour la représenter et agir en son nom. La famille lui accorde sa confiance et ce représentant contracte des dettes sensées répondre aux besoins de tous. Mais avec le temps, ce représentant en vient à contracter certaines dettes sans en informer la famille. Pire encore, même pour les dettes connues, leur utilisation sert davantage ses propres intérêts ou des priorités éloignées des besoins collectifs. Faut-il, dans ce cas, que le reste de la famille endosse :
• des dettes contractées sans son accord et utilisées à d’autres fins ?
• ou encore des dettes contractées avec son accord mais détournées au profit d’objectifs étrangers à ses priorités vitales ?
Dans les deux cas, la famille se retrouve accablée par un fardeau qui ne lui profite pas. Et pourtant, on continue de lui exiger des remboursements, alors même qu’elle peine à se nourrir, à éduquer ses enfants, à soigner ses malades, à se loger dignement, à assurer sa sécurité. Cette métaphore illustre, de manière volontairement simpliste, la situation du Sénégal : un pays contraint de supporter le poids d’une dette dont une partie n’a pas profité à ses citoyens, alors que leurs besoins essentiels restent dramatiquement insatisfaits.
CONCLUSION
Il renforce l’action publique au lieu de l’affaiblir, donne une assise populaire et morale aux négociations avec les bailleurs, et affirme que la dette doit être gérée dans la transparence et la justice. Ce n’est pas un aveu de faiblesse, mais une force nouvelle : celle d’un gouvernement qui parle au nom de la nation tout entière, avec le soutien de ses citoyens. Dans ce contexte, il a donc tout intérêt à s’appuyer sur son véritable mandant : le peuple souverain.